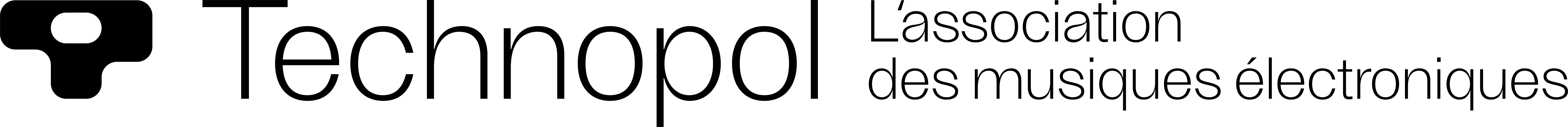La première édition de Danser Demain en 5 minutes
Inégalités sociales croissantes, politique sécuritaire, déclin – amorcé depuis belle lurette – de l’Etat Providence, libéralisation à marche forcée, vulnérabilité des minorités prises dans l’hypocrisie d’un universalisme républicain qui se maintient par une politique de plus en plus sécuritaire, le Covid-19 est certes une crise sanitaire (et l’on connaît encore mal ses conséquences économiques) mais ne fait que cristalliser une crise sociétale plus profonde qui, si elle est rendue davantage visible au printemps 2021, court depuis de longues années en France et ailleurs. Au coeur de cette crise de société, la place de la culture et le rôle de ses acteurs est devenu à mesure un impensé des politiques publiques, empressées à normaliser pour mieux contrôler, réduisant par une frénésie réglementaire les potentiels d’innovation dont le champ culturel a toujours été porteur, sondant avec un retard désormais homérique l’émergence pour l’accompagner a posteriori selon des schémas encore top-down et régaliens et des logiques de label menant à institutionnalisation, homogénéisation et devenir générique de cultures électroniques, festives et nocturnes pourtant des laboratoires de formes alternatives de faire ville, faire monde, faire société.
Continuer à inventer
Après un temps de torpeur et de stupéfaction devant une pandémie dont les conséquences à court et à moyen termes pour le continent électronique restaient (et restent toujours) une grande inconnue, ses acteurs, derrière l’association Technopol ont envisagé cette brusque reconfiguration des rythmes, des temporalités et de relations aux artistes comme aux publics pour prendre le temps de la réflexion avec « Danser Demain », cycle de rencontres et débats autour des futurs plausibles des fêtes dans le monde de l’après Covid-19, associant artistes, professionnels des industries musicales, mais aussi géographes, architectes, designers, performers et metteurs en scène en espace public. « Nous faisons face en ce moment au plus gros défi qu’aient connus les culture électroniques et les scènes nocturnes » prévient ainsi l’ancien Maire de la Nuit d’Amsterdam Mirik Milan en seuil de cette première conférence online le 9 mai dernier. Un temps de pause contrainte comme une occasion unique de réfléchir, et ce collectivement, en s’efforçant de penser les cultures électroniques comme un système complexe et interdépendant et en se permettant le changement de focale, la pensée à l’oblique en associant des experts d’autres mondes, d’autres disciplines, d’autres territoires. « Il y a en cette période une disponibilité des gens pour de vrais basculements, pour des métamorphoses intimes, personnelles ou même collectives, je le pense ou l’espère » formule ainsi Rone, invité de cette édition. Frayant non loin de l’injonction positiviste à tout « réinventer » rendue sensible par le pullulement de tribunes de toutes sortes exhortant le monde de la culture à innover tout azimuts au moment où, privée de corps et du vivant de ses spectacles, elle est le plus affaiblie, « Danser Demain » se place dans la continuité des efforts d’auto-description suggérés par Bruno Latour au début du confinement : qu’est-on prêt à abandonner dans nos fêtes de déjà hier ? pour quoi sommes-nous prêts à nous battre ? à quel prix ? qu’est-ce qui ne valait pas la peine dans ce « monde de l’avant » ? Et ceci dans l’urgence comme nous le suggère Jean-Michel Jarre : « Il faut profiter de ce moment pour se poser la question de revaloriser la culture de manière générale. Si l’on ne fait rien, 50% de ces acteurs en 2021 n’existeront plus. » mais également avec patience et optimisme à l’instar de Jack Lang en clôture de cette édition : « C’est une période où l’on doit confronter plus que jamais les intuitions, les idées, les projets. Il faut que 1000 projets puissent naître de cette période qui paraît une période morte (…) lorsqu’un pays est plongé dans la catastrophe, il faut évidemment faire face au plan sanitaire mais il faut s’en saisir pour en faire un instrument de renouveau et de changement. Je rêverais que l’on profite de ces prochaines semaines pour rebâtir la politique de la culture, la politique des arts ». En premier lieu, marteler que la culture ne peut survivre à l’injonction à l’économie d’échelle et au scale à l’oeuvre dans les business plans des GAFAM, que la création renie le monopole et l’uniformisation, que sa vitalité passe par sa pluralité comme le formule Jean-Michel Jarre. Mais aussi s’interroger sur nos imaginaires, sur nos échelles d’engagement, sur les manières de promouvoir la diversité et l’inclusivité.
L’After d’Après
Continuer, coûte que coûte, continuer, on ne sait pas trop quoi, continuer la nuit en plein jour, continuer pour remettre demain à demain, c’est ainsi que les plasticiens Trapier Duporté évoquent l’after party, une fête totale et presque sans fin dont nous sommes beaucoup ici les complices. Pour eux, si notre époque était une fête, on en serait à l’after party. Un after party qui grince, qui couine, qui chancèle, qui sent malgré toute l’énergie qu’on y met, un petit peu la Fin. L’after a été un imaginaire de la fête, romantique ou nihiliste, utopique ou décadent, très présent ces dernières années dans un monde dont les fictions collapsologues nous annoncent sans cesse l’effondrement à venir. Et puis un virus est arrivé, on connaît la suite. Depuis notre « Room With a View », on s’est mis à regarder le monde continuer sans nous, on a écouté un président de la République mobiliser des images guerrières dans ses discours, on a désappris à faire la fête comme on la faisait jusqu’alors. Le romancier Alain Damasio le dit, s’il y a une guerre aujourd’hui, c’est bien celle des imaginaires. Quels imaginaires la fête peut-elle permettre de régénérer ? Quelles sont les fictions et les mythes qu’elle mobilise auquel on veut continuer à croire ? Et comment on l’imagine, cette fête de demain ? Maud Geffray évoque l’actualité et sa peur de voir les nuits festives dénoncées partout comme des clusters potentiels, entraînant fermetures de clubs et de salles au pré-texte d’une supposée responsabilisation moindre des artistes. Comme Rone et (La)Horde, elle affirme le rôle central des artistes pour parler du monde, à travers l’imaginaire et le sensible, ainsi que l’activisme, afin de continuer à ouvrir des fenêtres et des possibles, d’autant plus que le spectacle vivant et les fêtes sont privés de leur essence : les corps en mouvement, la danse, l’interaction sociale, ces « dons de rien » échappant au système capitaliste selon le designer Paul Marchesseau qui invite à inventer un nouveau calendrier festif, en dehors des fêtes encouragées par le pouvoir ou le marché, de fêtes populaires et intergénérationnels, fédérant dans la célébration les habitants d’une même ville ou d’un même village. « J’ai peur qu’on perde la dimension transgénérationnelle de la fête. Dans les soirées qui me conviennent le plus, et même dans les fêtes de famille, ce que j’aime, c’est aussi le mélange des générations. On sait que la génération plus âgée est l’une des plus sensibles face à cette pandémie (…) La fête qui va le plus me manquer c’est la fête d’anniversaire, la fête de famille, la fête qui rassemble plusieurs générations. On sait que les plus âgés sont les plus exposés. C’est ce manque de mélange de génération qui m’inquiète pour demain » explique ainsi Arthur Harel de (La)Horde. La puissance de l’art est performative et cherche un impact sur le réel : il s’agit selon Arthur de continuer coûte que coûte à rejouer les effondrements, à faire de l’art un miroir constant du monde à même de visibiliser luttes et décontraction des systèmes de domination en place. C’est le sens de ces imaginaires de l’Après selon Marine Brutti de (La)Horde : « On nous demande de nous adapter à des manières de faire, nécessaires avec la crise sanitaire, mais qui réduisent comme peau de chagrin nos espaces de liberté. Je suis inquiète : cet appel à la résilience amène une docilité qui peut nous faire perdre le sens de la révolte. »
Le politique au corps
« Abandonner le corps, c’est déjà tomber dans une forme de censure » La formule de Jonathan Debrouwer de (La)Horde est claire et sans appel : privée de corps, la culture est affaiblie, et avec elles les démocraties – puisque celles-ci, de l’aveu de Jean-Michel Jarre « ont besoin de danser ». La société perd bien plus que la fête dans la fête suspendue par le confinement : elle perd un espace-temps ritualisé de rencontre et d’échange, de « dépense improductive » (Georges Bataille), un espace critique à même de générer des sociabilités alternatives, d’autres modes d’être au monde et à l’Autre, un espace de réflexivité sur le monde et d’engagement (Jacques Rancière, La Nuit des Prolétaires). Inventeur de Paris Plage et urbaniste à la Ville de Paris, Jean-Christophe Choblet rappelle le legs douloureux des années SIDA à Paris et ses corps devenus méfiants, la distanciation à l’oeuvre dans des fêtes remodelées par l’épidémie. Et quand des communautés privées de ce temps singulier et rituel social reviennent à la clandestinité historique des free parties, les acteurs des cultures électroniques misent sur la diffusion agile du livestream permettant avec peu de moyens pour les artistes et les lieux de diffusion de maintenir le lien avec leurs publics. Dans ce contexte, United We Stream amorcé à Berlin puis repris dans de nombreux pays a montré la réactivité et l’inventivité de la scène électronique pour se réinventer, enregistrant de grands succès d’audience. Pour autant, et pour l’ensemble des acteurs, la fête digitale n’a pas vocation à se substituer à la fête physique à laquelle tous reviendront avec joie lorsque les circonstances permettront de l’organiser en toute sécurité. La fête digitale reste une solution temporaire, répondant à une urgence martèle ainsi Mirik Milan « But I want to be absolutely clear : streaming from an empty club is a no way solution for nightlife. This is really something to show that we are unified, to show that we exist. United We Stream is a protest ». En écho avec l’actualité montrant sur différents réseaux des tentatives de fêtes distancées ou encore de concerts sur le mode Drive In, les intervenants oscillent entre amusement face à l’absurde de certaines situations et innovations intéressantes à l’image du Bon Air Festival à Marseille maintenant sa programmation initiale avec une édition numérique « Un Autre Air » hybridé avec une série de diffusions live dans des lieux musicaux et artistiques à faible jauge. La situation sanitaire et la nécessité à imaginer des fêtes à jauges réduites engage à une appréhension nouvelle des temps de la fête ; ce que suggèrent respectivement Mirik Milan invitant les pouvoirs publics à réfléchir à des licences 24/24h pour les clubs, et le géographe et spécialiste européen des night studies autour de la notion de chronotopie : imaginer des usages pluriels aux lieux en fonction des temps et des rythmes de la ville et, pour la fête : imaginer des fêtes dans des cours d’écoles le soir et a contrario, l’accueil de personnes en situation d’exil dans des clubs en journée par exemple. Une chose est certaine : « Les dispositifs éphémères de rencontre dont la fête seront au coeur des enjeux urbains demain et de la fabrique de l’espace public ».
La fête qui dure
Au coeur des engagements des acteurs des cultures électroniques : l’environnement et l’écologie. Les dernières années ont vu fleurir ci-et-là des initiatives encore clairsemées mais médiatisées de clubs ou de festivals prêtant une attention particulière à leur empreinte carbone. Des toilettes sèches aux ecocups, en passant par les mobilités des artistes ou du public, la tendance fut à une réflexion sur la durabilité des événements, parfois au risque du cosmétique ou du green washing. L’empreinte carbone est un des arbres qui cache la forêt d’un grand ensemble d’initiatives plus modestes et discrètes marquées par une prise en compte profonde du développement durable dont la relocalisation d’événements, des programmations plus centrées sur des scènes locales et émergentes, notamment celles que représentent les collectifs, mais aussi les dynamiques de réemploi et de mutualisation entre acteurs. Artistes et acteurs du continent
électronique s’interrogent sur l’impact de leurs pratiques (mobilité, rider, choix des festivals, rythmes et localisations des tournées) et sur leur responsabilité en tant qu’artiste au-delà du volet sensibilisation. Si certains comme Audrey AZF s’agacent de voir l’artiste sommé de manière systématique à l’exemplarité absolue, il est clair que l’engagement des artistes doit s’accompagner d’un alignement de l’ensemble de la chaine d’acteurs (organisateurs, agents, tourneurs, prestataires et fournisseurs ainsi que les publics dans leurs choix de consommation) dès lors que les industries musicales sont un système complexe et interdépendant : l’impact environnemental s’envisage au niveau macro, à partir des pratiques micro de chacun. Claire O’Neill ou Samy de Château Perché appellent ainsi au dialogue et à la coopération entre pairs, ainsi qu’à l’échange et à l’interpellation des pouvoirs publics comme accompagnateur, soutien financier et arbitre dans le respect de certaines normes environnementales tout en admettant que le temps de retard de ce dernier et la nécessité pour les acteurs de s’emparer sans attendre de ces questions, à travers des chartes ou des labels, des échanges de bonnes pratiques, l’apprentissage collectif des erreurs de chacun, la mutualisation inter-acteurs des ressources et méthodologies et une attention de tous les instants au local. « Il n’y a pas besoin de fonds faramineux pour faire une belle fête, il suffit de s’inspirer de ce qu’il y a autour de soi, et en premier lieux les artistes » exprime ainsi Audrey AZF. Au-delà, Samy fait état d’un potentiel de sensibilisation aux enjeux écologiques des festivals et événements : éveiller les esprits aux manières individuelles et collectives de s’agir à son niveau face à l’urgence climatique. « La fête des décennies précédentes était peu durable mais encore moins responsable. On est dans une maison en feu et le pire truc à faire c’est de danser dans la maison quand elle brûle et cette fête doit donc se politiser davantage, pour pouvoir prétendre à son droit de danser, elle doit se mettre en ordre de marche pour agir dans notre société, véhiculer des habitudes et des valeurs pour demain. »
Inclusivités festives
Un droit à danser, quand tout le monde pourra y prétendre. Les nuits festives disparues depuis mi-mars ont privé de nombreuses minorités (sociales, sexuelles…) d’un espace-temps salutaire de visibilité et d’accès au discours. En creux cela souligne le rôle central de la fête pour un grand nombre de communautés et des valeurs d’inclusion, de bienveillance, de consentement et de fluidité qu’elle mobilise, continuant à nous le dire : on pourra parler de droit à la fête lorsqu’il existera pour tous. Comment cette mise entre parenthèse momentanée de la fête peut amener une réflexion au long cours sur les moyens d’en faire un safe space durable ? Comment faire de la fête un espace-temps de porosité entre différentes communautés, un espace de déconstruction de rapports de pouvoir et de domination, une zone de frottements et de frictions fécondes. L’enjeu résumé par Chantal la Nuit de Garçon Sauvage : « gagner la bienveillance de l’autre, personne par personne, c’est le meilleur moyen d’arriver à des fêtes inclusives et safe au-delà de grands concepts généraux ». Trois collectifs, deux territoires (Paris / Lyon) avec Garçon Sauvage, Parkingstone et Spectrum pour échanger autour de la ligne de crête des safe spaces LGBTQIA+ : d’une part la volonté de favoriser à tout prix le sentiment de sécurité d’une communauté souvent privée de lieux d’expression jusqu’à privilégier des lieux de non mixité choisie, de l’autre le nécessaire travail d’inclusion et de pédagogie à destination de publics moins alertes. La place des lieux et des équipes dans la sensibilisation du public est au coeur du débat, ainsi que l’essor d’associations positionnées sur la formation, la prévention et le dialogue entre artistes, publics et organisateurs à l’image de Consentis ou A nous la nuit. « Un safe space est un espace qui doit être travaillé en permanence avec les équipes, les clubs, pour créer une communication avec tous les intervenants et apporter une sécurité au public durant tout l’événement » déclare ainsi David Hogan de Spectrum auquel répond Simone Thiébaud de Parkingstone : « Le safe space on le créé nous-mêmes, on a pas de lieu attitré et c’est peut-être cela qui nous manque. On doit à chaque fois repartir de zéro avec les lieux qui nous accueille. » Et cela, au cours d’un travail de longue haleine, sur le terrain, main dans la main avec les communautés de publics habituées de ces soirées, alors même que l’explosion du « queer »comme argument marketing pour nombre d’événements invite à la grande prudence quant à sa potentielle récupération, en une période de confinement qui a montré comment l’absence de lieux safe, d’échange et de refuge a pu peser sur la communauté queer.
Les fêtes comme laboratoires R&D de l’Après ?
Les nuits festives, même contraintes et ralenties, doivent ainsi pouvoir prolonger l’expérimentation à l’oeuvre par chacun de ses acteurs, inventer au jour le jour des nuits plus durables, engagées et inclusives, pour accompagner si ce n’est précipiter les transitions nécessaires de nos sociétés, comme un miroir déformant, une prolepse ou un cheval de Troie. Comme le signale Luc Gwiazdzinski « La nuit et la fête ont beaucoup de choses à dire au jour (…) La nuit c’est l’ambiguïté entre liberté et contrôle, une position qu’il faut sans cesse négocier, un statut avec lequel il faut ruser. La nuit échappe encore au domaine comptable. elle existe autrement que par la lumière des Lumières et grâce à elle, nous aussi. On peut remonter de la nuit dans le jour des nuances et ambiguïtés, une sensibilité qui échappe à la froide raison du jour. Dans nos sociétés et nos villes fonctionnelles et aseptisées, la fête nocturne nous permet de nous retrouver. Elles deviennent l’outil du temps commun. La fête peut mettre de la folie, des corps, du frottement, de l’imprévu, de l’aléatoire, de l’improvisation contre le panoptique de nos sociétés. Comme toujours en temps de crise, la fête prend une dimension essentielle et en période de déconfinement la “possibilité d’une fête” est une question éminemment politique et symbolique, un indicateur de bonne santé ou non de nos sociétés ». Constat partagé par Jack Lang : « ll y a dans ce pays où nous sommes un extraordinaire maillage de créateurs indépendants de toute sorte, du design au club, du théâtre au cinéma, ce sont des viviers extraordinaires. J’aimerais que nous profitions de cette période pour que les cultures indépendantes soient reconnues, épaulées, encouragées, soutenues. C’est un vrai défi. Si on ne le fait pas ce sera grave. Les gros mastodontes anglo-saxons vont s’emparer des petits festivals qui aujourd’hui viennent de mourir de telle ou telle compagnie et la concentration va aller grandissante. C’est le pire ennemi de la liberté la concentration, je l’ai toujours pensé, je le pense encore. Small is beautiful, il faut préserver la capacité de chacun à inventer sa vie, son espace et si l’on ne fait rien dans les prochaines semaines alors on aura une prise de pouvoir par les puissances financières qui déjà occupent le haut du pavé. » C’est une occasion historique à saisir. Il faut renverser la table. Il ne faut pas craindre de bousculer, de dépoussiérer, de casser même des habitudes. « On aimerait que mille fleurs surgissent, que cette période qui pour l’heure est sombre puisse être le signe d’un renouveau. Si l’on le veut on le peut. Les dirigeants le peuvent s’ils écoutent la réalité vivante du pays, et notamment la jeunesse. L’art et la culture sont le moteur de tout, il ne faut pas casser le moteur mais le remettre à neuf, sans oublier ce qui a été fait avant. »