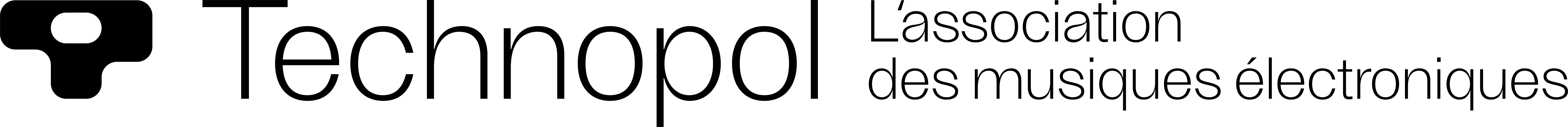La deuxième édition de Danser Demain en 5 minutes
C’est le 24 juin dernier que la seconde édition de Danser Demain a pris place, toujours en ligne, mais dans un contexte particulier puisque, contrairement à la première édition, en temps de déconfinement avec de nombreuses lignes mouvantes dans les nuits festives depuis mai. En effet, si l’économie reprend timidement et que les salariés retournent au bureau, si les trains reprennent la marche et que le rayon de 100km n’est plus une donnée, si chacun peut sortir à présent plus d’une heure et au-delà d’un kilomètre de chez lui et s’asseoir à la terrasse d’un bar, les cultures électroniques restent dans leur grande majorité confinées. Clubs intérieurs fermés, jauges réduites pour les open airs, contrôles accrus et interdictions de la Préfecture tombant en couperet, souvent au dernier moment, les acteurs de la nuit ont pu se demander si continuer dans de telles conditions pouvait vouloir la peine, et se sont tournés vers les pouvoirs publics pour trouver des compromis entre une fête surveillée et contrôlée, et les dédommagements possibles, qu’ils soient de l’ordre du financier ou de la marge de manoeuvre, pour faire exister les fêtes tant bien que mal.
La fête malgré tout ?
Parmi les tentatives de faire exister la fête en temps de (dé)confinement, on a vu le festival marseillais Le Bon Air tenter de retrouver du souffle avec la version digitale Un Autre Air, re-territorialisée dans quelques lieux de diffusion marseillais à faible jauge comme Voiture 14, le programme de livestream de Technopol et Arte Concert lancer en France, dans de nombreux clubs et avec un écosystème d’artistes de tous horizons, l’édition française de United We Stream après son tonitruant succès berlinois, mais aussi du côté de Vincennes ou de la grande couronne éclore ci-et-là des free parties ressuscitant l’aventure des sound systems des débuts des années 90. En marge, certains tiers-lieux ont pu redimensionner leurs modes de diffusion pour garder vivant le lien entre artistes et publics, au prix de nombreux compromis. Dans une France qui se remet tout doucement à vivre, à l’orée du second tour des municipales, les acteurs culturels ont pu faire le constat d’une absence relative de propos et de décisions (ou de décisions tardives) concernant le champ de l’art et de la culture. « Ne rien dire de la culture lors de la dernière allocution présidentielle, c’est déjà dire que celle-ci est dangereuse, un cluster » formule ainsi Kevin Ringeval, membre du CA de Technopol. De quoi se questionner sur les rapports conflictuels et paradoxaux entre cultures alternatives et puissance public.
Fêtes & politiques, liaisons dangereuses ?
En creux des fêtes légales ou illégales résonnant en marge des villes chaque weekend, des tribunes ont émergé de toute part, rendant sensible la situation paradoxale – et par là même inconfortable – entre un secteur culturel indépendant (fédéré autour de l’Appel des Indépendants lancé depuis Lyon, au début du confinement, par Arty Farty) entre la revendication d’une certaine forme d’autonomie, le plébiscite d’un assouplissement des normes en temps de crise sanitaire et la nécessité d’aides publiques au chevet d’un secteur coupé de ses publics, et donc de revenus. Appel à l’interventionnisme étatique ou injonction à une marge retrouvée, le discours ambiant a pu parfois manquer de clarté et mettre au jour la fragilité d’un secteur culturel dépendant des corps et du vivant. Kevin Ringeval revient sur la frénésie réglementaire de la part de pouvoirs publics se positionnant davantage en censeurs qu’en partenaires de sortie de crise, minorant là les potentialités à l’innovation et au DIY et prêtant le flanc du champ culturel à une hégémonie des grands groupes, seuls capables de viser l’économie d’échelle et le scale, et ainsi absorber l’arsenal de normes à l’oeuvre. « En multipliant règles, interdits et injonctions, les dirigeants de nos gouvernements successifs ont fini progressivement par rendre les métiers de producteur et les initiatives citoyennes impossibles (…) l’innovation si chère à nos politiques n’a plus l’opportunité d’émerger ailleurs que dans des espaces conventionnés, des espaces sous contrôle (scènes nationales, SMACs, festivals subventionnés… (…) détruire le vivre-ensemble au prétexte du Covid-19 qui au passage nourrit plus encore les GAFAM est une idée qui fait son bonhomme de chemin chez nos politiques : une société normée où le spectacle vivant n’aurait plus sa place. » synthétise Kevin Ringeval. L’injonction exogène sommant les mondes de la culture, comme d’autres secteurs, à se réinventer en temps de crise a pu agacer nombre d’acteurs décelant dans ce positivisme ambiant une pente facile vers la mise en frugalité forcée des lieux culturels, et en première ligne les clubs et salles de concerts affectés par les impératifs de distanciation sociale, contre-sens structurel avec leurs usages quotidiens. Et si le déconfinement progresse sans trop de heurts, avec les récentes réouvertures des terrasses, les rassemblements de plus de dix personnes restent interdits, illustrant bien la possible dérive sécuritaire à l’oeuvre de cet état d’urgence sanitaire dont on ne connaît le terme et qui pourrait devenir la norme des prochains mois voire années. La norme en question, c’est le sujet de cette table-ronde : l’occasion de voir comment la norme et la normalisation sont les écueils majeurs pour ces lieux d’expérimentation que sont les scènes des cultures électroniques, l’occasion également d’imaginer les tactiques possibles pour les hacker, les contourner, les court-circuiter, voire jouer avec ces contraintes. En écho, Olivier Babeau, Président fondateur de l’Institut Sapiens. Chroniqueur et essayiste, il a cofondé en décembre 2017 la 1ère Think Tech française revient sur le contrôle permanent de l’Etat sur la fête et la culture et son instrumentalisation potentielle au travers notamment de l’histoire paradoxale et conflictuelle du Ministère de la Culture : la culture, fait du Prince. Il évoque la rationalité souveraine de l’Etat et son impossibilité à faire corps avec le côté dionysiaque de la fête, creusant à mesure l’écart entre culture autorisé et cultures alternatives. En culture il faut faire très attention, il y a ce qu’on voit et ce qu’on ne voit pas. Quand un état se prévaut des créations qu’il a permis, on ne saura jamais toutes les créations qu’il a empêché. On ne saura jamais ce qui aura pu émerger sans le pouvoir. C’est le principe de l’état culturel qui fait de la culture sa chose. « La culture n’est vraiment vivace que si elle est transgressive. (…) Mais la transgression est la roue qui fait évoluer la culture et on peut le voir dans toute l’histoire de l’art. Les grands artistes sont des artistes transgressifs.(…) C’est ainsi une opportunité extraordinaire ce Covid de se libérer de l’emprise des règles. De faire comprendre que la culture ne se fait pas à travers les productions qui passent par les fourches caudines de l’administration, la vraie production artistique se fait dans le surgissement de la transgression. » A la suite des analyses du sociologue des cultures urbaines Hugues Bazin ou encore des prises de position du sociologue et grand acteur des free parties Lionel Pourtau, on pourrait analyser le développement des clubs et des lieux dédiés aux cultures festives, encouragés par les pouvoirs publics, comme une manière de contrôler les acteurs de la fête en leur imposant un certain nombre de normes, de contraintes et d’impératifs mettant à mal leur économie et leur capacité d’expérimentation. Cette « maladie de la pierre » peut être momentanément – par l’exceptionnalité de la situation sanitaire – et peut-être plus durablement si des expérimentations prenant forme durant la période dans l’espace public, par des clubs contraints de s’exporter hors-les-murs, s’avèrent concluantes. Le metteur en scène Ludovic Nobileau, actif dans l’espace public, nous parle ainsi de celui-ci comme d’un lieu de possibles, que l’on a souvent trop tendance à penser comme un espace d’interdits en s’auto-censurant. La censure est d’abord et avant tout une forme d’auto-censure du corps social dans ce qu’il pense ne pas avoir le droit de faire. Avant d’être artiste il faut être juriste, connaître le droit et les contraintes qu’il impose pour mieux le contourner. S’assurer également d’être accepté par son territoire. À force de se concentrer sur ce que l’on ne peut pas faire, on risque de s’auto-censurer. Il faut savoir inventer des astuces : jouer sur les temporalités, les rythmes, les interstices : des opéras dans le ciel, des fêtes sur des passages cloutés, du micro-raving : « Les institutions ne sont pas préparées à l’improbable, ils ne savent plus réagir avec leurs schémas ». Pour s’autoriser et s’encapaciter, il importe d’ancrer les fêtes de demain dans un territoire, au plus près de ses populations, afin de réduire les zones de frictions et de conflits d’usages. En écho, Lucien Krampf & Paul Seul de Casual Gabberz en appellent à ne pas fantasmer les house parties, le streaming ou les free parties, rappelant que les clubs jouent un rôle de premier plan dans la professionnalisation des artistes et l’accès à des conditions matérielles, logistiques et financières importantes. L’espace public s’avance néanmoins comme un lieu de tests, d’expérimentation et de jeu pour les fêtes à venir en mobilisant des arts du détournement, de contournement, de ruse, de hacking et de tricks sur lesquels les arts de la rue par exemple ont d’ores-et-déjà beaucoup réfléchi. Il s’agit de trouver les modalités de fêtes prenant place dans des Zones d’Utopie Temporaires, encouragées par les pouvoirs publics sans prétention à la normalisation, et réinvestir dans l’espace nocturne et festif le droit à l’erreur prôné depuis quelques années par l’urbaniste Patrick Bouchain et La Preuve Par 7 dans la fabrique de la ville.
Festivals engagés : pairs, puissance public, temps long et localisme
Du côté des festivals engagés en faveur du développement durable en revanche, Béatrice Macé, fondatrice des TransMusicales à Rennes martèle la nécessité de faire des pouvoirs publics des partenaires de premier plan, insistant sur le caractère systémique d’un festival et la nécessité, pour un impact réel, de réfléchir aux incidences de l’ensemble des décisions prises sur la chaîne d’acteurs. Avec des outils tels que des normes (ISO), des chartes et des labels, le champ culturel a le potentiel, par un travail entre pairs et en dialogue avec les partenaires publics qui encouragent, soutiennent et mettent en réseau, de se questionner plus en profondeur sur l’impact des industries créatives sur l’environnement et d’esquisser des pistes concrètes de solution. « Le développement durable nous reconnecte à un environnement global : on ne peut plus dire que l’on est en apesanteur (…) Soit on va à la catastrophe soit on décide de travailler collectivement. Le système entier doit être remise en cause. Cette dégradation de l’environnement est issue d’un modèle dominateur et extractiviste. Il faut que ça s’arrête, point » exprime ainsi Béatrice Macé. Commencer humblement, au plus près du terrain et expérimenter au niveau local avec artistes et producteurs locaux, c’est le pari du festival italien Terraforma à la suite de son fondateur Gaetano Scippa : « not just make music and dance, but work with the territory (…) we need to remind that sustainability doesn’t mean necessarily juste not waste, plastic etc. but also include the social part » Le producteur et DJ Simo Cell, à la suite d’une tribune publiée sur Libération, revient quant à lui sur sa responsabilité d’artiste, et ses leviers d’action tant au niveau de la mobilité (des tournées moins nombreuses mais plus longues, des riders éco-responsables en dialogue avec tourneurs, salles et bookers) : « Il y a des choses qu’on a faites comme artiste qui ne faisaient déjà plus trop sens mais qu’on ne pourra désormais plus faire aujourd’hui comme si de rien n’était ». Dominique Crozat, spécialiste de la nuit, engage également le public à faire ses choix parmi l’offre culturelle existante, en parallèle de l’évolution progressive de la société sur ces questions : « Le développement durable n’est pas seulement l’écologie, c’est aussi une autre manière de s’envisager dans le monde et la piste locale va dans ce sens (…) La fête est un miroir des sociétés, c’est un excès qui suit la société. Si celle-ci évolue, la fête réduira-t-elle ce gaspillage symbolique. La fête c’est rationnellement inutile. Je ne vois pas pourquoi on serait toujours parfait avec l’écologie qui est aussi une démarche rationnelle. (…) Le modèle type Ibiza de fête globalisée, ce n’est pas encore derrière nous, mais cela va paraître de plus en plus ringard ». Au nombre des pistes prospectives pour une fête plus durable, outre privilégier les scènes locales ainsi que les acteurs économiques et artisanaux des territoires, la solution semble être à trouver du côté du temps long : celui des longues tournées sur des territoires restreints, celui aussi de la résidence au long cours, permettant dialogue créatif avec la scène locale, rencontre en amont avec le public et temps de création au-delà de l’événement. Les festivals restent en tout cas des endroits d’expérimentation possibles, des endroits également où l’on fait preuve, où l’on démontre, des espaces-temps privilégiés de sensibilisation et d’apprentissage.
Décoloniser le dancefloor
Les nuits festives disparues depuis mi-mars ont privé de nombreuses minorités (sociales, sexuelles…) d’un espace-temps salutaire de visibilité et d’accès au discours. En creux cela souligne le rôle central de la fête pour un grand nombre de communautés et des valeurs d’inclusion, de bienveillance, de consentement et de fluidité qu’elle mobilise, continuant à nous le dire : on pourra parler de droit à la fête lorsqu’il existera pour tous. Comment cette mise entre parenthèse momentanée de la fête peut amener une réflexion au long cours sur les moyens d’en faire un safe space durable ? Comment faire de la fête un espace-temps de porosité entre différentes communautés, un espace de déconstruction de rapports de pouvoir et de domination ? Si la première table-ronde du 9 mai s’était attachée à des exemples de fêtes mettant à l’honneur la communauté LGBTQI+, levant à l’occasion des débats sur la capacité des fêtes à générer des liens inter-générationnels, c’est une autre dimension centrale que nous désirons fouiller à l’occasion de cette seconde table-ronde : quels modalités d’accès des personnes racisées, qu’elles soient artistes ou publics, aux différents milieux des cultures électroniques. Malgré ses valeurs d’inclusion, d’ouverture et de bienveillance, qu’en est-il en son sein des trajectoires des personnes racisées ? A rebours, quelle prise de conscience et déconstruction des privilèges d’hommes et de femmes blanches dans le milieu ? Et quelles bonnes pratiques pour mettre au coeur des fêtes des communautés plurielles, mouvantes et accueillantes ? Premier paradoxe : les racines afro-américaines de la House (Chicago) et de la Techno (Détroit) font comme l’objet d’une négation mémorielle que l’historien de la musique Philippe Birgy impute au rôle de l’export des musiques électroniques en Europe et de la presse faite à Kraftwerk et consorts de la new wave mancunienne ayant éludé la riche histoire américaine du beats et, selon CrystallMess l’amour de la France pour les mots et une appétence plus grande pour le rap et le RNB chez les jeunes générations. Un important travail de pédagogie est nécessaire pour réhabiliter cette mémoire. Conséquence dans les clubs en Europe : la faible représentation de personnes racisées dans les line-up, due à une frilosité ou un manque d’imagination des programmateurs et une déficit de légitimité des communautés racisées. « Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas dans cette scène parce qu’ils ne se sentent pas légitimes. » explique ainsi Crystallmess rejointe par Alexia de Filles de Blédards : « On se sentait comme des weirdos de l’immigration, de ne pas être la fille d’immigrée qui écoute du rap, de ne se sentir ne légitime chez soi dans sa famille à écouter la musique que l’on avait envie d’écouter et dans la scène électronique. et de se rendre compte qu’il y avait beaucoup d’artistes dans notre cas (…) Ce n’est pas seulement parce qu’il n’y a pas assez d’artistes dits racisés qui font de la musique électronique, c’est aussi qu’il est complexe de créer des espaces comme les nôtres, de trouver des lieux qui sont touchés aussi par ces problématiques. » Pourtant les choses évoluent à mesure avec une prise de conscience généralisée du monde des cultures électroniques avec la prise de parole de nombreux artistes racisés, des prises de positions d’acteurs et des politiques volontaristes telles que les mesures prises par Bandcamp et une visibilisation croissante de la question de l’inclusivité et de la représentation de minorités dans la scène club. Néanmoins la lutte ne doit pas se borner à la représentation des artistes racisés, qui bénéficient d’opportunités croissantes mais de la représentation de ces communautés au sein de l’ensemble de la chaîne d’acteurs des musiques électroniques : gérants de clubs, bookers, programmateurs, agents etc. « En dehors de la représentation, des corps noirs qui performent comme DJs ou danseurs, ce qu’il manque c’est la représentation de personnes racisées à toutes les étapes et échelles des musiques électroniques. Il est plus facile pour une personne noire d’être artiste, c’est un peu ce qu’on attend de nous que de performer, que d’être dans les institutions ou que d’avoir sa propre structure et d’en être décisionnaire » formule ainsi Crystallmess. En creux, c’est de la nécessité de trouver des espaces festifs safe et inclusifs, conscients de ces enjeux et volontaires quant à faire bouger les lignes. « En France il y a un problème avec les lieux, avec la fête, des lieux ferment à la pelle notamment à Paris, ces fermetures menacent la fête de manière générale et derrière cela les personnes racisées qui avaient trouvé refuge dans ces lieux DIY » exprime Crystallmess rejointe par Alexia de Filles de Blédards « Cette question va du propriétaire de lieu jusqu’au videur – il faut parvenir à expliquer qu’un mec de cité avec des TN en jogging il peut entrer dans une fête electro. Politiquement et éthiquement, c’est un combat de tous les jours ». Parmi les leviers d’action, l’auto-validation communautaire comme un passage obligé d’encapacitation à même d’anticiper les changements qu’Alexia appelle de ses voeux, des dispositifs d’entraide communautaire comme la tontine que pratiquent Filles de Blédards, ainsi que l’hybridation des programmations et des sonorités pour hybrider par rebonds les publics. Paradoxe : la récupération possible de l’esthétique de ces communautés par des lieux ou des labels opportunistes, peu sensibles aux luttes engagées par collectifs et artistes mais flairent l’opportunité marketing à se saisir – en surface – de ces questions. Une situation qui place les artistes face à un dilemme : rester dans un underground d’alliés sincères ou gagner en visibilité pour donner de l’impact aux luttes quitte à faire des compromis. C’est ce qu’exprime Alexia de Filles de Blédards : « Il y a un côté tendance à ces questions. Il y a beaucoup de personnes qui n’ont jamais voulu entendre nos récits qui savent que c’est à la mode, qu’ils peuvent capitaliser sur ces esthétiques et c’est super dur pour nous de rester fidèles à nos principes et de ne pas travailler avec ces grosses structures qui se servent de notre image voire nous fétichise. Je n’ai pas de réponse pour le moment à part continuer à travailler entre nous. Malgré ça ça fait un bail que je mange des pâtes, on paye nos artistes parce que c’est super important mais on ne se paye pas (…) Le vrai dilemme c’est est-ce qu’on continue comme cela ou est-ce qu’on se scinde : des soirées alternatives avec des personnes racisées mais pour des personnes blanches qui payent 20 balles ? Il faut que l’on trouve un équilibre. Continuer de faire vivoter cette scène alternative à Paris ça devient très compliqué. La période du Covid nous a énormément touché. Il y à l’écueil, pour des raisons financières d’aller vers des choses mainstream qui ne nous ressembleraient plus. » Une fois encore, une question de mémoire selon Crystallmess : « Il faut suivre ceux qui s’investissent depuis le départ, et pas ceux qui se sont réveillés ces trois dernières semaines. Le challenge c’est d’aller à la source, retrouver ceux qui se battent depuis des années, qui n’ont pas été récompensés et sont encore ostracisés pour leurs lutte et ne pas aller chercher la version édulcorée, light et confortable »
Le continent électronique, laboratoire R&D du monde de l’Après ?
En fil rouge de cette seconde édition de Danser Demain, la fête comme espace public et le nécessaire dialogue à nouer avec les politiques publiques pour une meilleure appréhension de ses enjeux, fragilités et pistes d’avenir. Le parti-pris de Technopol est celui, en écho à l’Appel des Indépendants, d’états généraux des cultures alternatives et indépendants afin de faire émerger, par les pairs et pour les pairs, les pistes de sortie de crise des cultures électroniques. C’est ainsi un temps préliminaire, pensé sans les acteurs politiques, pour ne plus attendre des décisions régaliennes mais innover au plus près du faire et des territoires puisque, comme le formule Mati Diop : « Ce n’est pas que tu es en avance. Tu es dans ton temps. C’est la France qui est en retard. » Une posture à assumer pour faire du continent électronique une chambre d’écho des expérimentations qui s’inventent chaque nuit sur les dancefloors, dans les studios et sur les plateformes comme laboratoires recherche & développement des nuits à venir, et servir de porte-voix à des enjeux sociétaux plus larges qui traversent les nuits comme le jour.