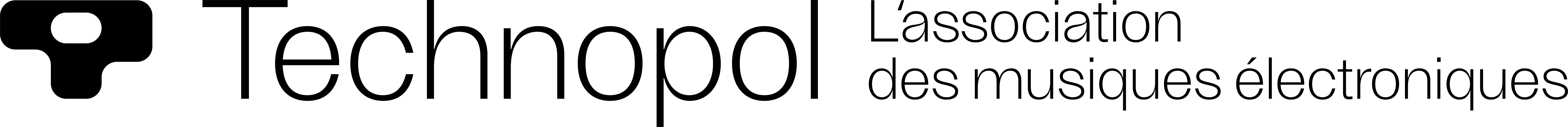Ludovic Nobileau : “ll faut réfléchir à quels sont nos espaces de liberté et ce que nous pouvons faire pour les transcender”
En mai dernier, le metteur en scène et spécialiste de l’espace public Ludovic Nobileau intervenait lors de la première table-ronde virtuelle Danser Demain, organisée par Technopol. Dans la lignée de ce pôle de réflexion qui vise à penser les enjeux de la fête, il revient sur la notion de norme dans l’espace public et sur la manière dont la France s’en saisit. Une interview menée par Arnaud Idelon.
Comment définirais-tu ta pratique et qui es-tu ?
Je suis “interprète d’espaces publics”, c’est-à-dire que je travaille sur les notions d’espaces publics et je vois comment elles s’inscrivent dans d’autres pratiques artistiques, citoyennes et collectives. A côté de ça, je suis metteur en scène de théâtre, initialement, et j’ai quitté les grandes salles pour avoir une approche plus immédiate de ma pratique.
Tu as justement quitté la scène ; est-ce que l’espace public est une autre scène ? Et quand on parle de norme, est-ce qu’on peut considérer que c’est un lieu plus libre ou au contraire plus contraint ?
Je pense que c’est un lieu plus libre, parce que je trouve que le théâtre impose énormément de règles, énormément de normes et c’est une pratique qui peut ne plus être très spectaculaire après un certain moment pour les personnes qui la pratiquent. Il y a beaucoup moins de surprises et on perd cette forme d’immédiateté qui m’intéresse, moi, de plus en plus : le fait de pouvoir travailler dans la poursuite d’une nébuleuse de rencontres et de suivre une pratique que je n’aurais pas si elle n’avait pas lieu dans des espaces plus surprenants ou même peut-être plus contraignants, en effet. Mais il y a moins de normes dans l’espace public tout simplement parce qu’il se construit collectivement, ce sont donc des normes qu’on peut être amenés à transformer, à transposer, il y a toujours la possibilité d’aller au-delà des murs, au-delà des normes qu’on croit être imposées : en fait, dans un espace public, il n’y a pas grand chose qui soit réellement obligatoire, si ce n’est le respect de l’autre.
Et alors, cette norme dans l’espace public : elle est exogène ou endogène ? Est-ce que c’est un arsenal de normes qui vient de l’extérieur, de l’Etat, de la puissance publique ou c’est plutôt quelque chose qu’on intériorise à travers une forme d’auto-censure ?
Je dirais que c’est plutôt une forme d’auto-censure : dans toutes les pratiques, ce qu’on peut voir, c’est que les gens s’imposent eux-mêmes des règles, s’imposent une forme de morale… “On ne peut pas faire ça !”, “Ca ne se fait pas !”, “Pourquoi tu fais ça ?”, ce sont des réactions presque puériles que les gens arborent parfois ; c’est comme si l’espace public était un espace de représentation et non pas un espace de vie qu’on pouvait partager. La notion d’espace de représentation induit que les gens ont un rôle à jouer dans l’espace public, notamment dans la manière dont ils se comportent, et ça met en exergue pas mal de comportements sociaux et de clichés – on se tient bien, comme si on était à table en famille, tout est normé et policé, on voit assez peu d’exubérance, contrairement à des pays comme l’Angleterre où pour le coup l’espace public est un espace de représentation beaucoup plus exubérant.
C’est vrai que c’est un cliché qu’on a souvent en tête, le fait que la France soit un pays plus normé que d’autres, est-ce que donc selon toi la France est un pays de norme, notamment dans l’espace public ?
Je pense qu’on a moins cette notion démocratique de l’espace public qui nous appartient et qu’on co-construit. Et dans cette lignée, on a affaire à une forme de privatisation de l’espace public, on est censés être poussés vers une vision démocratique, presque républicaine de l’espace public mais j’ai l’impression que beaucoup d’espaces ne sont pas montrés comme tels. Je pense toujours par exemple à l’Ecole Normale Supérieure rue d’Ulm qui possède un sublime jardin ouvert au public alors que personne ne sait que c’est un espace public : donc on ne dit pas, on ne montre pas aux gens que ces espaces sont ouverts à tous et il y a beaucoup d’espaces publics que je dirais emblématiques qui se retrouvent de fait privatisés, auxquels beaucoup de personnes pensent qu’elles ne pourront jamais accéder. C’est un espace public presque caché, sauf pour les plus privilégiés ; certaines personnes se sentent à l’aise et vont investir certains espaces tandis que d’autres ne vont même pas savoir qu’ils existent, et même si elles le savaient, n’y iraient probablement pas.
Ce que tu dis, c’est que finalement, au lieu de voir un levier en l’assouplissement de la législation, il faut avant tout commencer par un travail de pédagogie sur les possibilités de l’espace public pour tout un chacun ?
Oui, complètement. Et montrer que ce n’est pas une question de norme, une question de règles, c’est vraiment une question d’appropriation, de pouvoir se sentir à l’aise, parce que beaucoup de gens dès qu’ils vont se sentir mal à l’aise dans l’espace public vont devenir provocateurs et faire l’inverse de ce qu’ils devraient faire, c’est-à-dire de refuser d’intégrer une notion d’espace en se disant “Ce n’est pas pour moi, c’est nul, je vais aller mettre le bazar” donc il y a tout un rapport à la légitimité dans l’espace public. Le fait d’être légitime fera qu’on aura un comportement plus proche de nos aspirations personnelles et même collectives.
Est-ce que tu pourrais nous dire deux mots sur ton projet “Le code de la déconduite” ?
Ce projet est justement né de l’observation d’une situation qui est survenue lorsque j’ai projeté un film face à un public d’enfants de 10 ans : dans la séquence, je lançais des balles de ping-pong sur les marches de Montmartre et les enfants ont directement réagi en me disant que ce n’était pas possible de faire ça alors que dans le film on voit deux policiers se retourner et éclater de rire. C’est à ce moment-là que je me suis dit qu’il y avait un vrai problème de conscience et de connaissance du droit et des possibilités de l’espace public, et je me suis demandé s’il ne fallait pas faire un espèce de “code de la déconduite” afin de retracer les différentes pratiques pour avoir une meilleure connaissance du droit et montrer que celui-ci est par essence une création collective : c’est quelque chose qui s’écrit, qui n’est pas entièrement imposé ou même gravé dans le marbre. Une loi est vouée à changer, à évoluer voire à être abolie ou créée ; et donc ce projet est né de ce constat-là. On a fait pas mal de performances, d’une part au Théâtre du Rond-Point, d’autre part à Marseille en 2015 lors de la crise des migrants, afin de déterminer si les habitants étaient réfractaires à leur accueil – ils ne l’étaient pas du tout. Ensuite, ces questionnements-là ont débouché vers d’autres questions : est-ce qu’on peut, nous, en tant que citoyens, représenter une force de paix, et si on assiste à une dérive, est-ce qu’on peut intervenir et agir en conséquence ? Donc à chaque fois, il s’agit de s’emparer d’une ville et d’une pratique pour déboucher vers d’autres interrogations. Si on prend par exemple le sujet du cimetière, on comprend rapidement que les gens ne savent pas comment un cimetière fonctionne ; maintenant la plupart des cimetières sont privatisés et gérés publiquement, notamment par les maires. Si quelqu’un choisit de mettre une inscription décalée sur une stèle comme l’a fait un artiste rouennais en inscrivant “Mort de rire” sur sa tombe, le gestionnaire du cimetière est sommé d’enlever l’inscription si quelqu’un se plaint, comme cela a été fait dans ce cas précis. C’est à travers des aberrations comme celles-ci qu’il faut réfléchir à quels sont nos espaces de liberté et ce que nous pouvons faire pour les transcender.
Tu as participé au cycle de réflexion “Danser demain” de Technopol, qui porte sur la fête, lors duquel tu es intervenu avec ton point de vue particulier : qu’est-ce que tu peux nous dire, toujours en rapport avec cette forme d’auto-censure dans l’espace public et sur tous les possibles que ça ouvre une fois qu’on s’affranchit de cette auto-censure, sur ce qui s’ouvre comme champ de réflexion sur la fête dans l’espace public et notamment pour une fête qui est, avec le COVID-19, vue comme un cluster potentiel et nécessite une forme de distanciation sociale ?
Pendant la table-ronde, j’avais évoqué le fait de retrouver des formes beaucoup plus ritualisées de la fête ; on peut penser un rituel totalement inventé, c’est-à-dire que cette distanciation sociale pourrait constituer un jeu ritualisé, comme une forme de pratique de la danse, où il va y avoir une cadence, des espaces, une manière de la pratiquer… Après ça change complètement la donne d’une fête spontanée et chaotique, mais ça fait évoluer les pratiques – il s’agit par exemple d’organiser une sorte de pogo à distance, d’organiser une fête dans un lac, alors que ce n’est pas un lieu privilégié de la fête, mais dans l’eau il y a une forme de distance naturelle. J’avais aussi pensé à la forêt, et ce serait grâce aux éléments que les gens ne se côtoient plus avec autant de proximité, ils pourraient danser avec un arbre au lieu de danser avec quelqu’un d’autre… Enfin je ne sais pas si c’est forcément pertinent, mais il y a quand même l’idée que ça peut créer d’autres rituels. Après il y avait aussi l’idée d’organiser des fêtes de thérapie spontanée qui se crée et se disperse, mais c’est difficile de se positionner là-dessus…
J’avais aussi l’impression, dans ce que tu dis sur le vernaculaire, le populaire, que finalement si la norme et l’auto-censure qui se pratiquent dans l’espace public sont avant tout issues de ce qu’on a personnellement intégré, plus la fête sera ancrée, située et populaire, moins elle aura de résistance sur une personne ou un territoire, et donc moins on pourra l’interdire. Qu’en penses-tu ?
C’est pas tant le côté populaire mais davantage le côté rituel, il s’agit de créer d’autres paradigmes et d’autres éléments qui font partie de la culture consciente d’un pays et qui vont beaucoup plus loin que la fête païenne du village. Je pense qu’en englobant beaucoup plus les gens qui n’ont pas cette pratique, ça peut être bien plus enthousiasmant que de se sentir dans une rave isolée du monde. Car la fête, ce n’est pas être isolé du monde, ça doit se partager.